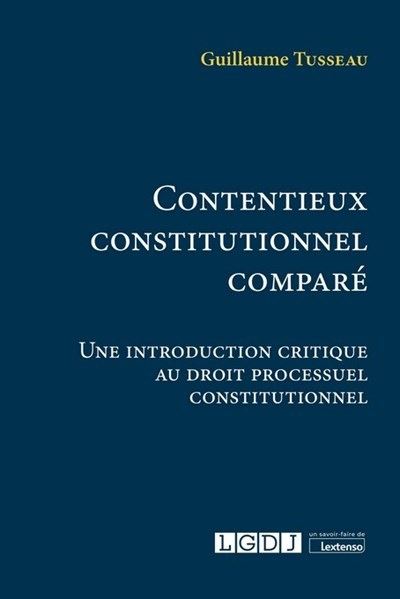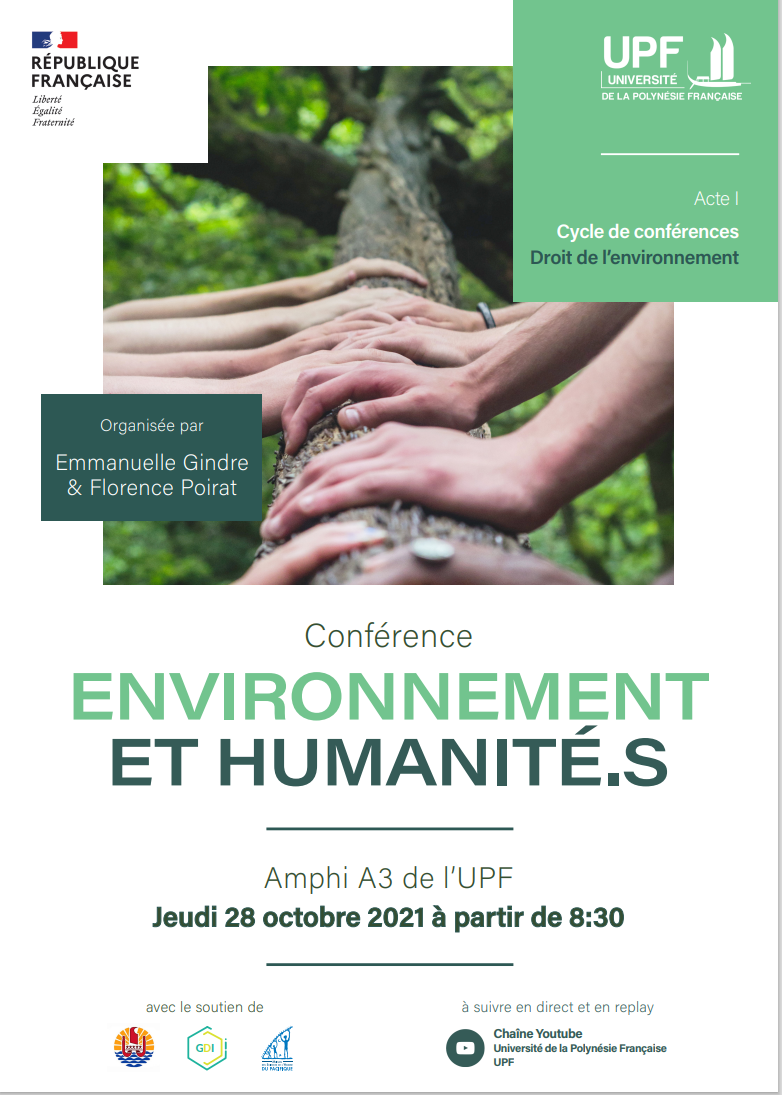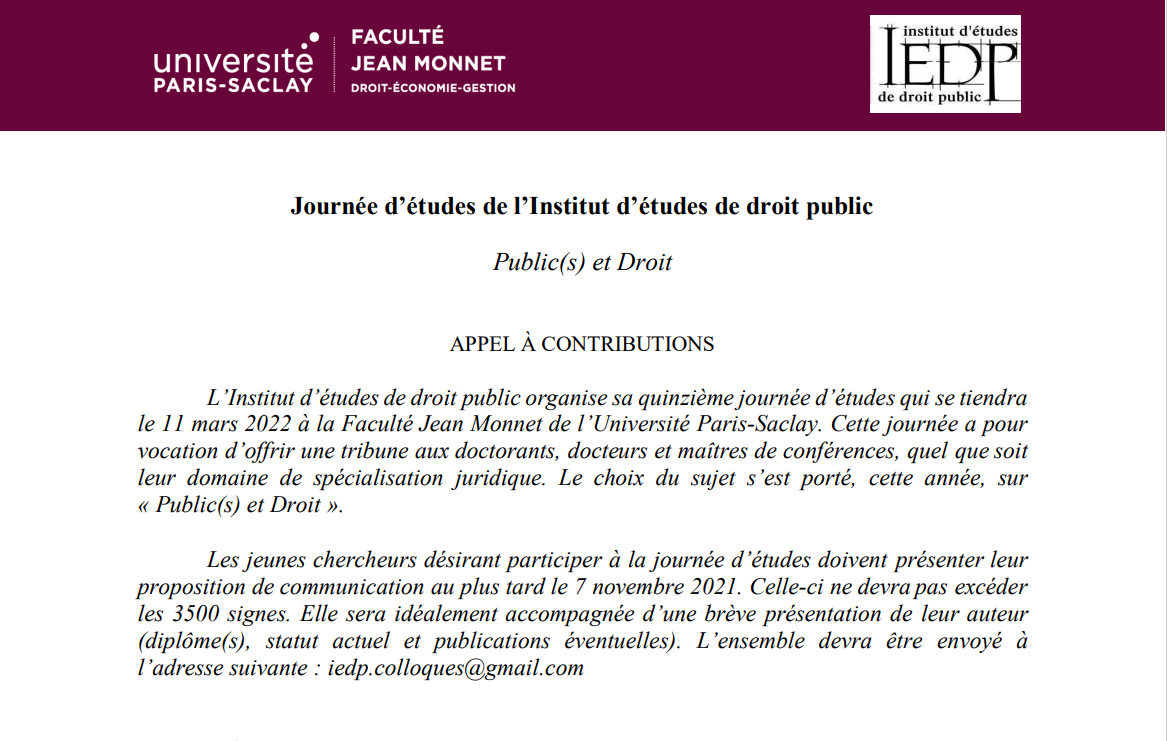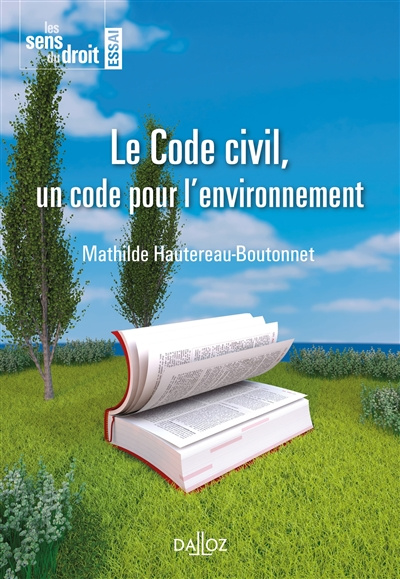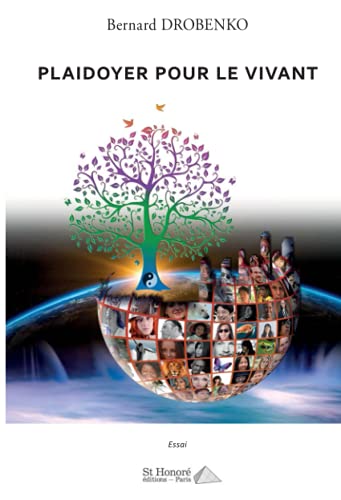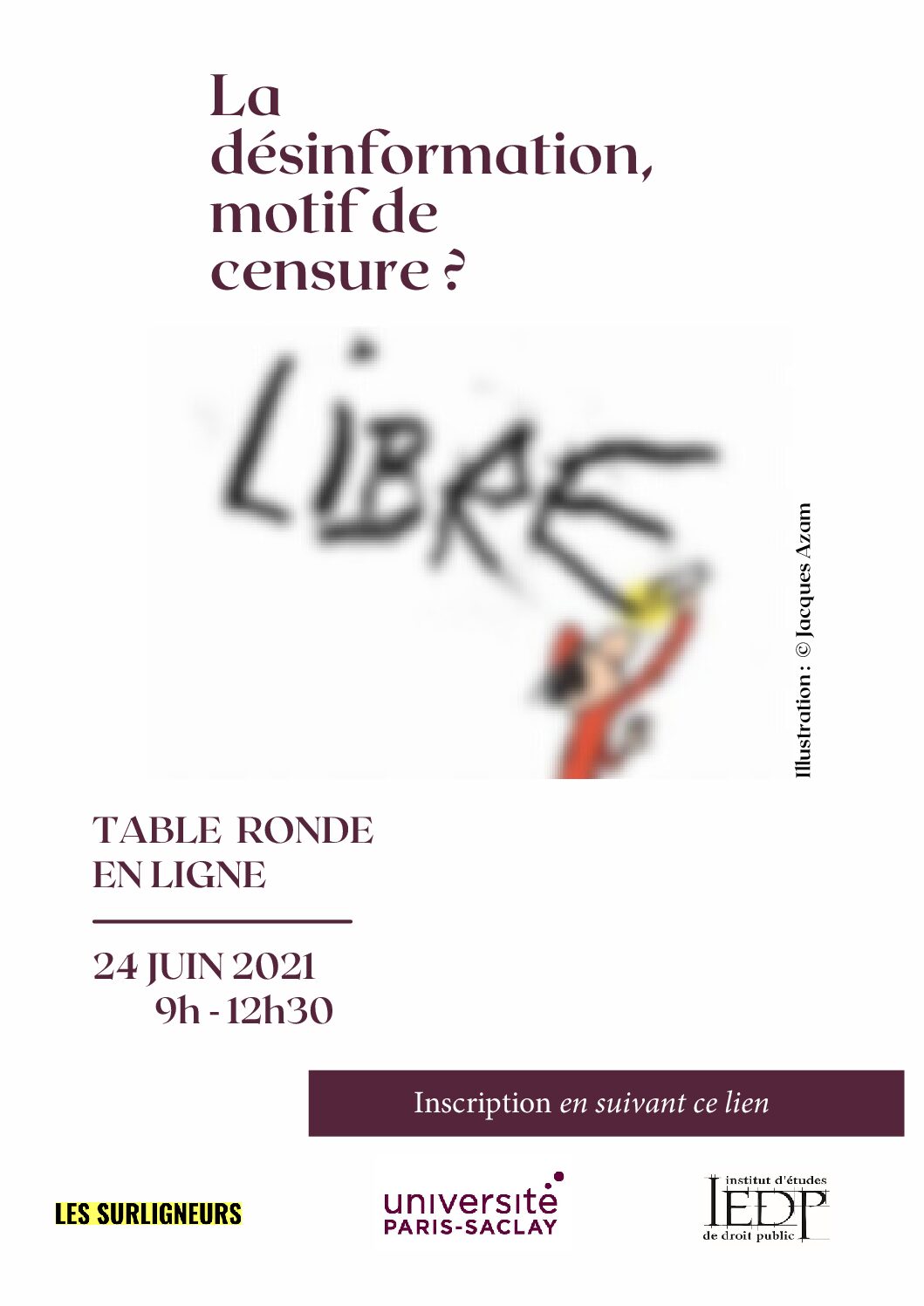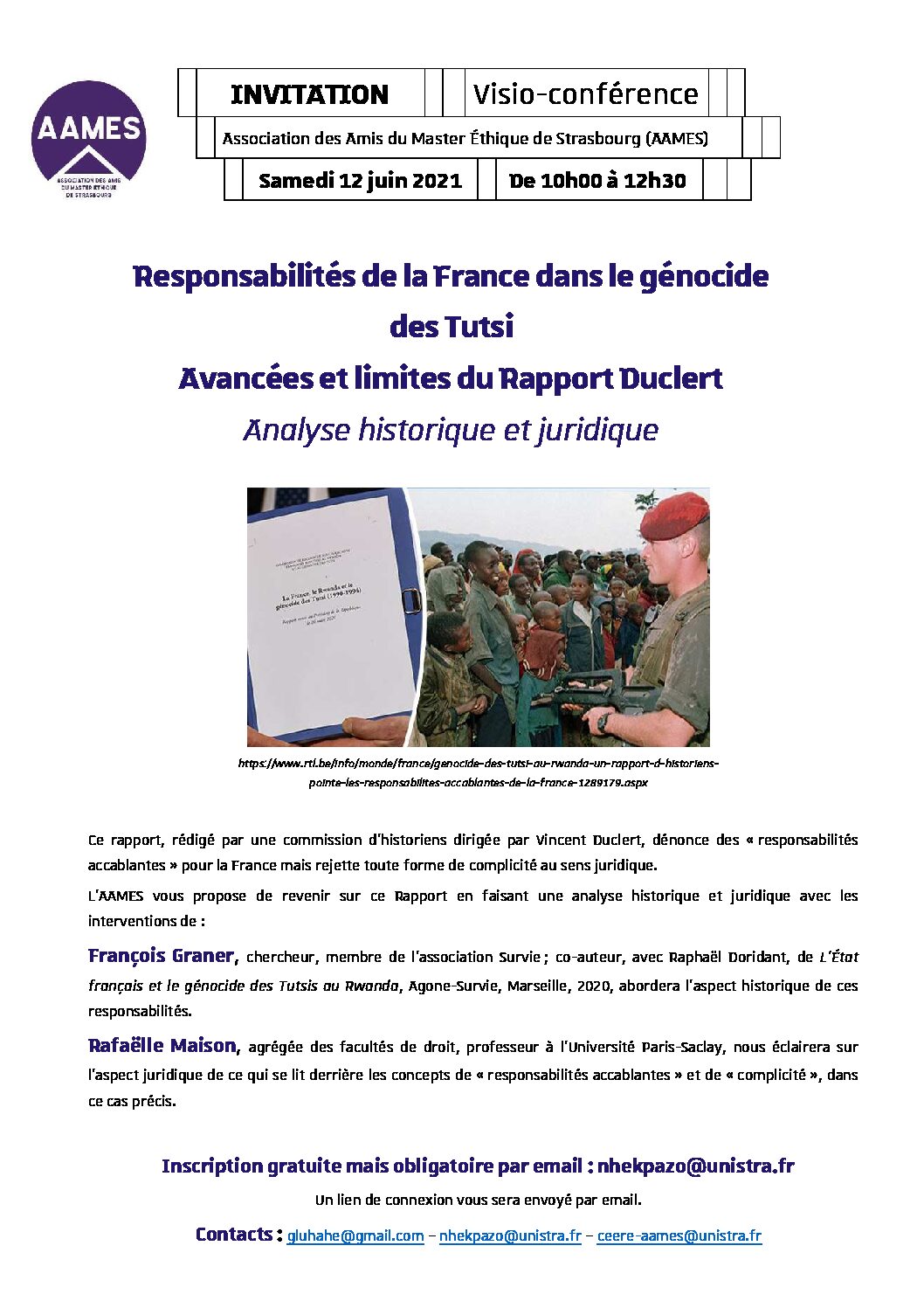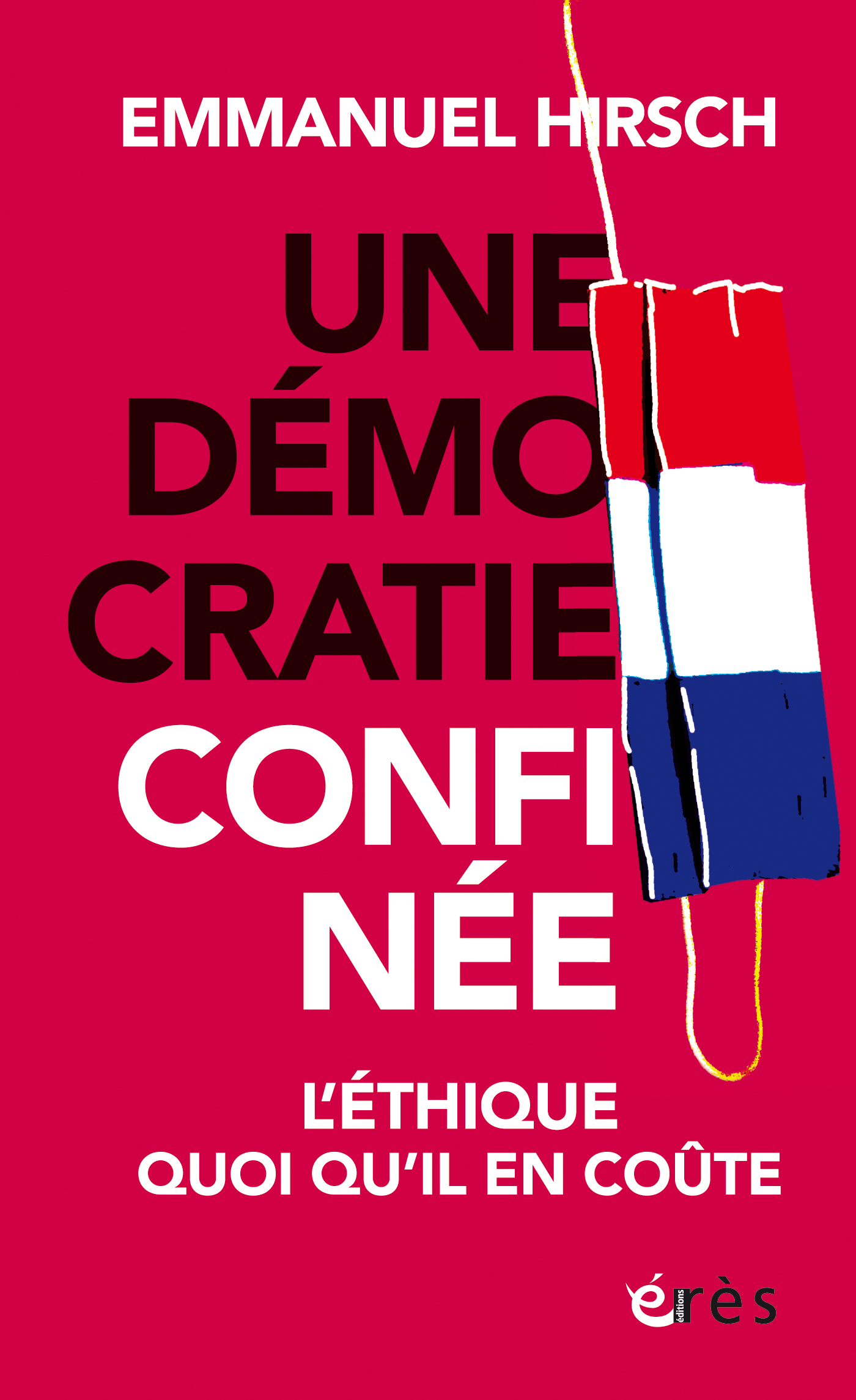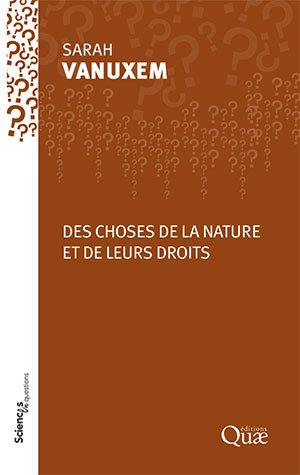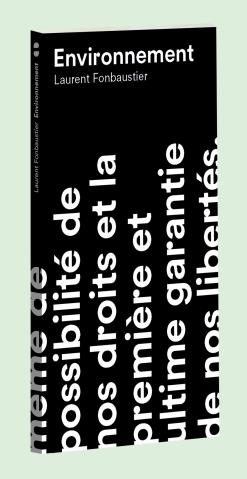Les Soirées de l’IEDP
Guillaume Tusseau, Professeur de droit public à Science Po Paris et ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature présentera son nouveau traité :
Contentieux constitutionnel comparé. Une introduction critique au droit processuel constitutionnel, LGDJ-Lextenso, 2021
Jeudi 25 novembre 2021 à 18h en Salle Vedel
Discutants :
Julien Boudon, Raphaël Paour et Charles Vautrot-Schwarz
Accessible par visio-conférence :
https://eu.bbcollab.com/guest/bbc1964c1e1a4dd89c527aeb2b4650f8